Le réseau paysan est une initiative qui regroupe des ancien.ne.s et des élèves de l'ISTOM autours de l'agriculture paysanne, en organisant des rencontres, des visites de ferme et des interventions pédagogiques au sein de l'école. Découvrez ici une série de portraits d'ancien.ne.s réalisés par des élèves de 5ème année de l'ISTOM.
Est-ce que tu peux nous parler du fonctionnement de ta ferme ?
La ferme avait initialement une vocation de polyculture élevage laitier. Le lait était vendu en coopérative, et les céréales étaient produites en quantité suffisante pour être vendues en complément des fourrages. Elle s’étend sur 95 hectares, dont 30 en prairie permanente, le reste étant destiné aux cultures de céréales, oléagineux et protéagineux. Il y a 12 ans, le fils des fondateurs s’est installé en créant un fournil pour transformer les céréales en farine et en pain. Deux autres personnes les ont rejoints, et ils étaient alors quatre associés. Aujourd’hui, la ferme compte quatre associés, un apprenti qui s’installera prochainement, et une salariée. L’atelier laitier n’a pas été repris car ils n’ont pas trouvé de candidat.
Quant à moi, je suis arrivée en 2021, au moment du départ à la retraite d’une des associées. J’ai commencé par des stages et du salariat, avant d’entamer une période test d’installation d’un an via le dispositif Start’agri. Je me suis finalement installée en 2022, deux ans après ma sortie de l’ISTOM. La ferme est en bio, sur 106 hectares (dont 25 hectares de prairie permanente). Nous faisons de la pension pour génisses — des éleveurs nous confient leurs animaux lorsqu’ils manquent de surface fourragère. Les moutons des voisins viennent également pâturer chez nous. Nous produisons aussi du foin pour la vente. Le reste des 80 hectares est en rotation. On arrive à ne pas labourer pour les implantations d’automne, mais nous n’avons trouvé de solutions pour éviter le labour pour les cultures de printemps sur terres argileuses.
On cultive donc plusieurs céréales que nous transformons en farine et en pain. Récemment, nous avons commencé à développer un atelier sans gluten, avec des cultures comme le sorgho et le sarrasin, suite à la découverte d’une maladie cœliaque chez l’un de nos associés. On fait aussi un peu de bière. Dans beaucoup de systèmes paysans-boulangers, la surface agricole est limitée. Vendre du pain est alors plus rentable que de vendre de la farine. Chez nous, grâce à une moindre pression foncière, on peut se permettre de vendre également de la farine. Nous commercialisons nos produits au fournil, sur les marchés, via des caisses de dépôt, ce qui permet d’aller vers les gens, dans un contexte de région peu peuplée, très rural et à faible pouvoir d’achat. On fournit aussi des magasins bio, des épiceries et un magasin de producteurs.

Qu’est-ce qui t’a motivée à devenir paysanne ?
Je savais que je voulais m’installer, mais je ne pensais pas le faire si rapidement. Je voulais avant tout me former et acquérir de l’expérience en salariat. Or, comme cela coûte cher aux employeurs, seules les structures prévoyant une installation future forment véritablement leurs salarié.es. Cette ferme représentait une opportunité unique : un système humainement, économiquement et politiquement idéal, qui me correspondait parfaitement.
C’est un cheminement des années Istom, de savoir ce que je voulais faire à la sortie. Pendant nos études, on prend conscience de l’urgence écologique et sociale, et qu’il n’y a pas de temps à perdre pour agir. On réalise aussi que ceux qui ont le plus de poids sur leur environnement, que ce soit sur la qualité de l’eau, de l’air ou de l’alimentation, ce sont les agriculteur.ices. L’ISTOM m’a surtout appris à comprendre l’imbrication des situations, le « pourquoi du comment », à ne pas juger trop vite et à reconnaître la complexité de la mise en place de systèmes sur le long terme. Pour moi, avoir un impact signifiait agir concrètement. Sur un plan personnel, je savais que je ne voulais pas vivre en ville, que je voulais travailler en extérieur. Je voulais cultiver de grandes surfaces pour bien faire les choses et porter un message politique fort avec une agriculture biologique et nourricière. Vivre en autarcie ne m’a jamais intéressée. Ce qui m’animait, c’était l’envie d’apporter des solutions concrètes.

Qu’est-ce que l’ISTOM t’a apporté, et manqué pour ton métier d’aujourd’hui ?
D’un point de vue personnel, la fameuse adaptabilité m’a finalement appris à être humble. Comprendre pourquoi les gens agissent comme ils le font est essentiel, car sans cette compréhension, on risque de se marginaliser et de rater ses objectifs. Les grilles de lecture qu’on nous enseigne pour appréhender un nouvel environnement m’ont été très utiles, que ce soit pour m’intégrer dans la ferme ou dans la région. Côté technique, je me sers des bases en microbiologie pour la fabrication du pain, des mathématiques et physique pour l’auto construction, et de la compta au quotidien. Par contre, on a des lacunes en agronomie. Par exemple, la lecture de paysage manque cruellement : on peut passer tous les jours devant des champs sans vraiment comprendre ce que l’on voit. J’aurais aimé que certains débats soient actualisés, notamment sur des sujets comme les systèmes de cultures. Par exemple, discuter de l’utilité du labour n’est plus vraiment d’actualité.
Quelles ont été tes principales difficultés à l’installation ?
Outre certaines lacunes en agronomie, l’intégration sociale en milieu rural est un défi. Il faut comprendre un vocabulaire spécifique, le nom des machines agricoles, des bleds du coin…et trouver sa place dans l’exploitation. Pour ça il faut être pro-actif, force de proposition et de décision. Heureusement, j’ai eu énormément de chance sur tous les plans : un bon entourage pour m’aider dans les démarches, peu de frais à engager, et des associé.es patient.es pour me former, une coloc toute trouvée…Bref, la reprise d’une ferme existante facilite énormément l’installation, même si la première année, tout s’enchaine très vite dès qu’on commence à parler de sous, c’est beaucoup de charge mentale.
Il faut aussi noter que les paysans boulangers en France s’en sortent bien, que ce soit sur le plan financier ou en termes de temps de travail, comparé à d’autres systèmes comme le maraîchage, qui demande davantage d’efforts pour des revenus souvent moindres, il faut être conscient de cette injustice…

Quels conseils donnerais-tu aux istomien.nes tenté.es par l’installation ?
Je dirais déjà que c’est à la portée de tout le monde, à condition de se former. L’installation est chronophage et exige une réelle implication, au-delà que l’activité même. C’est une manière de vivre qui fait que qu’on traine beaucoup avec des paysans, on parle agriculture, on lit agriculture, c’est un monde auquel on commence à appartenir. Il faut être prêt à investir beaucoup de temps dans la compréhension du métier et des systèmes agricoles. Autrement, ça m’a beaucoup aidé de trainer sur les sites des ADEAR, de la confédération paysanne, ou des chambres d’agriculture, qui regorgent de ressources pour les porteur.euses de projet : formations, témoignages, guides pratiques. Ces personnes ont beaucoup d’expérience et bénéficient d’un vrai recul sur l’installation maintenant, et sur des territoires localisés. Prendre le temps de discuter avec ses voisins et les gens qui font la même chose que vous, le plus tôt possible, établir de bonnes relations, s’avère essentiel, tant pour l’entraide que pour l’intégration sociale.
Il faut être conscient que les ventes directes sont certes rémunératrices, mais très chronophages. Après quelques années dans le milieu agricole, je dirais que des systèmes mixtes circuits courts/circuits longs allient rentabilité, efficacité et peut-être moins de temps de travail, ce qui au final n’est pas négligeable. C’est à chacun.e de s’adapter à son contexte local : ici par exemple le lait IGP gruyère est bien payé, et les contractualisations avec les laiteries sont plus sécurisantes qu’avec Lactalis.
Pour ceux qui prévoient de s’installer en collectif, rejoindre une structure existante est une stratégie qui fonctionne bien à mon avis : le système économique tourne déjà et les risques sont limités.
Chercher des opportunités liées aux départs à la retraite, car reprendre une ferme en activité est souvent plus simple que de tout créer de zéro, surtout dans un contexte national ou les systèmes en vente directes commencent à se faire sacrément concurrence un peu partout.
Enfin, il ne faut pas hésiter à tester son projet avant de se lancer, grâce aux dispositifs de périodes test ou d’apprentissage sur le terrain. Cela permet de valider ses choix et de bien se former.

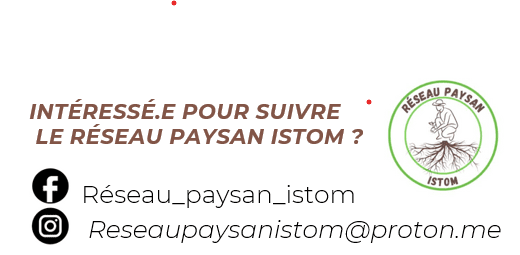
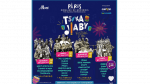
Galerie d'images4
Commentaires0
Vous n'avez pas les droits pour lire ou ajouter un commentaire.
Articles suggérés







